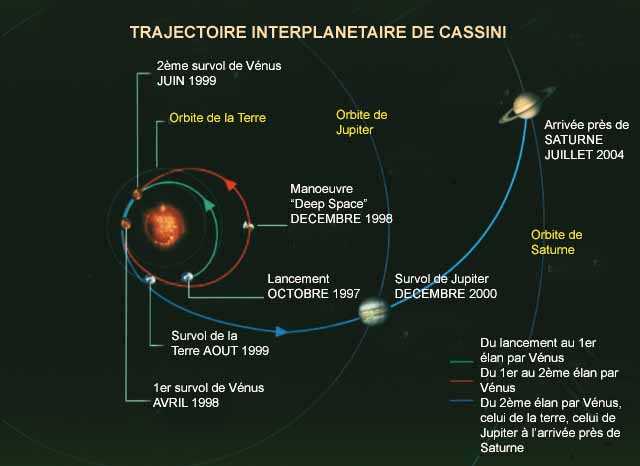
A) INTRODUCTION
Tout d’abord, il faut
savoir que l'idée de l'assistance gravitationnelle ,
appelée aussi réaction de gravitation, fronde
gravitationnelle ou effet catapulte (slingshot
effect) est relativement récente, elle date
en effet du début des années 60 et a été découverte
par Michael Minovitch (étudiant de l’UCLA qui
travaillait l’été au JPL).
La technique d’assistance gravitationnelle permet d’expliquer
la complexité de la trajectoire de Cassini. Si Cassini
devait aller directement jusqu’à la planète
lointaine Saturne (« en ligne droite »), elle
devrait être propulsée dans l’espace à 10 km.s-1 !
Or le propulseur Titan IV ne peut la propulser qu’à
4 km.s-1.
Cassini va donc acquérir un complément de vitesse
grâce à l’accélération gravitationnelle que lui
imprimeront les planètes survolées.
Aussi, la sonde suivra un chemin détourné (trouvé
après un examen de milliers de trajectoires) qui la
mènera deux fois à proximité de Vénus, puis au
voisinage de la Terre et enfin aux abords de Jupiter qui
lui donnera sa dernière impulsion.
La trajectoire prend donc
avantage du fait que Jupiter, qui est la planète la plus
massive du système solaire ( et donc la meilleure pour
utiliser l’assistance gravitationnelle) est au bon
endroit par rapport à Saturne (du même côté du soleil)…
Cette technique d’assistance gravitationnelle permet
d’économiser l’équivalent de 68 tonnes de
carburants ou plusieurs dizaines d’années de voyage.
En résumé, la trajectoire de la sonde Cassini comporte
deux parties principales : la navigation (avant
Saturne : 3.2 milliards de km) et l’exploration
(1.7 milliards de km en orbite).
B) DESCRIPTION GENERALE
Les lois de Kepler appliquées aux
orbites elliptiques, n'impliquent que 2 corps. Lorsque 3
corps sont impliqués il faut effectuer quelques
modifications et approximations. Dans le cas ci-dessous,
une sonde spatiale est envoyée, sur une orbite autour du
soleil, vers une planète. Cette orbite suit une ellipse
autour du Soleil. La planète n'interagit pas avec la
sonde jusqu'à ce que cette dernière en soit
suffisamment proche. Alors, la gravité l'emporte sur
celle du Soleil et la sonde "tombe" vers la
planète. Cette région s'appelle la sphère d'influence.
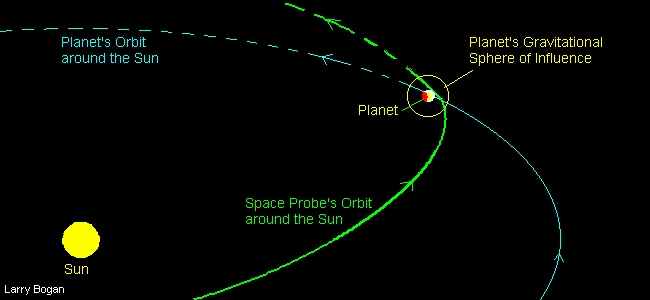
A l'intérieur de cette zone, la sonde
est en orbite autour de la planète, plutôt qu'autour du
Soleil. La sonde est entrée dans la sphère de l'influence
avec une vitesse supérieure à la vitesse de libération
de la planète et de ce fait elle est obligée d'en
sortir et d'échapper ainsi à la sphère d'influence.
Cependant, près de la planète, le parcours sera
hyperbolique plutôt qu'elliptique et son centre de
déplacement sera la planète plutôt que le Soleil. Une
fois la sonde sortie de la sphère d'influence de la
planète, elle retrouvera son parcours sur une orbite
elliptique, mais différent de celui précédent l'arrivée.
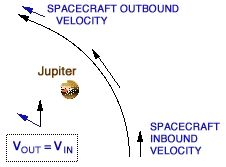
Ce shéma montre la vitesse de la sonde spatiale par rapport à Jupiter. La sonde repart à la même vitesse que celle qu'elle avait lorqu'elle est arrivée aux alentours de la planète, bien que sa direction ait changé. Cependant il faut noter l'augmentation de la vitesse de la sonde lorsqu'elle approche au plus près la planète.
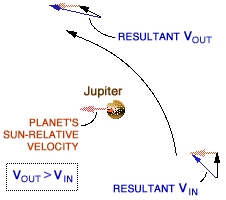
Ce shéma montre que lorsque l'on prend le soleil comme référentiel, il faut ajouter la vitesse la vitesse orbitale de la planète à celle de la sonde. La sonde ne perd donc pas de ce composant lors de sa sortie. La planète quant à elle perd de l'energie. La perte massive de la planète est trop faible pour être relevée, mais le gain d'énergie apportée à la sonde peut-être très important.
C) CHANGEMENT DE REFERENTIEL
Le passage de la sonde à l'intérieure de la sphère d'influence de Jupiter (orbite d'insertion) dépend de la vitesse et de la position de la sonde à l'entrée de la sphère.
La vitesse dépend de l'orbite au vaisseau spatial et la vitesse de Jupiter. Le schema ci-contre représente la traduction dans le référentiel de Jupiter où la vitesse de la sonde est de 7,91.km/s.
Cela est supérieur à la vitesse d'évasion de Jupiter et le vaisseau spatial passera rapidement au-dessus de la planète en quittant la sphère d'influence à la même vitesse.
D) REACTION DE GRAVITATION
Afin d'accroître l'énergie d'une sonde spatiale, il faut passer par plusieurs étapes:
- établir l'orbite et ses paramètres de vol de la Terre à Jupiter.
- sélectionner un point où la sonde entrera dans la sphère d'influence avec la transformation de la vitesse relative à celle de Jupiter.
- déterminer l'orbite hyperbolique de la sonde dans la banlieue de Jupiter.
- ramener la vitesse sur l'orbite hyperbolique en quittant la sphère d'influence, à la vitesse dans le Système solaire.
- déterminer la nouvelle orbite autour du Soleil.
Ainsi, le principe de l'assistance gravitationnelle résute de tout une série de paramètres que les scientifiques ont abordés afin d'établir la trjectoire de la sonde. Cette assistance gravitationnelle est en grande partie dûe à la force d'attraction des planètes que la sonde a rencontré lors de son voyage lui transmettant ainsi de l'énergie pour arriver à la prochaine planète-relais et enfin ,après la dernière, à Titan. Ce principe trés économique est de plus en plus utilisé pour les voyages interplanétaires. Un des premières avant Cassini-Huygens a l'avoir utilisé est Voyager 2.